
Le Banquet, n°23, mars 2006.
Débat entre Marcel Gauchet, Alain Finkielkraut, et Nicolas Tenzer
[...]
Marcel Gauchet : L'arraisonnement du réel bute sur une limite qui est que le réel se rappelle à notre bon souvenir. De ce point de vue, l'interpellation écologique est, en effet, riche de sens. Tout n'est pas possible contrairement à cette idée enracinée chez nos contemporains selon laquelle, s'il est entendu que tout n'est pas possible dans l'ordre politique, en revanche, tout est possible dans l'ordre économique et technique et dans l'ordre des droits des individus. La rencontre de la limite de fait est extrêmement importante. Il n'est pas vrai, de manière générale, que nous évoluions dans l'apesanteur absolue. Pour reprendre l'exemple du rapport au passé, le divertissement pascalien consistant à se promener à l'intérieur des monuments de toute l'humanité pour éviter d'avoir à penser que ce passé vous a fait, existe, certes, et puissamment, mais il ne parvient pas à étouffer chez les mêmes individus une sourde inquiétude sur ce qu'ils sont, c'est-à-dire sur leur provenance historique. Ils devinent que quelque chose leur manque pour se comprendre. Cette frustration représente une ressource politique dont il faut apprendre à se servir.
Nicolas Tenzer : Je voulais marquer un accord sur l'inquiétude que vous avez exprimée et que je ressens. Il suffit de rencontrer des étudiants pour voir que ce que nous avons vécu par l'entremise de nos parents, et qui appartient encore à notre histoire personnelle, est quasi inexistant, sauf chez une petite poignée. Tout se passe comme si, pour beaucoup, l'histoire commençait à une date très récente. Même des événements comme la Shoah, les deux guerres mondiales, la Guerre froide, ou Mai 68 sont vécus comme des éléments extérieurs à leur vie, sans résonance, morts, comme le sont pour nous le code d'Hammourabi – et encore ! ‑, la guerre des Deux Roses et la bataille de Marignan. Il en va de même pour les grandes œuvres de la littérature universelle. Même quand l'histoire est connue – ce qui est de plus en plus rare ‑, elle ne suscite plus la référence ou l'émotion, ce qui vaut aussi pour ce qu'on pouvait appeler jadis la « mémoire militante », avec ses grands moments que furent pour la gauche française, par exemple, la Commune, le Front populaire et la guerre d'Espagne. Tous ces éléments, qui sont fondateurs de nos actions et réactions au XXe siècle, pour le meilleur et pour le pire, ont en grande partie disparu. J'ai été très frappé par une réflexion que m'avait faite à Belgrade un intellectuel serbe après le référendum, évoquant notamment le vote majoritaire des jeunes en faveur du « non » : « J'ai l'impression que les Français ont perdu toute conscience historique ». Cette phrase était le renvoi de quelqu'un qui avait vécu l'histoire sous sa forme classique, ses horreurs, la dictature, les meurtres, les assassinats de masse à partir desquels nous devions agir dans le présent. Il était pour lui incompréhensible et désespérant que l'histoire des nations de l'Est européen au cours du XXe siècle n'ait en rien pesé dans la décision.
Mais revenons à l'économie. L'économisme habillé des droits de l'homme pose une question qui n'est pas évidente à trancher : de quelle manière, pour autant que cela soit possible, pouvons-nous séparer les deux sphères, celle de l'économie et celle de la politique ou du projet politique dans ce qu'il peut avoir de porteur de civilisation et d'émancipation ? Pouvons-nous opérer la césure entre, d'un côté, l'économie avec ses contraintes et ses mécanismes, de l'autre, la dimension politique et celle de la civilisation ? C'est-à-dire, pour exprimer, les choses concrètement : d'un côté, accepter en limitant et en régulant, une part de détermination économique, ce que l'économie emporte du point de vue positif en termes de niveau de vie et, de l'autre, construire de manière disjointe un projet politique qui n'est pas uniquement le correcteur des maux de économie, mais qui permet de prendre en charge et de répondre à la question de la civilisation. Mais je ne sais pas plus que vous si l'on peut recevoir les bienfaits de l'économie sans développer ce que Castoriadis appelait un « imaginaire capitaliste », hypertrophiant la mode et la consommation vaine et véhiculant, sous les auspices classiques du pain et du cirque, une « société de l'oubli ». Nous manquons peut-être d'une nouvelle École de Francfort, la révérence au marxisme et la tentation utopique en moins.
Marcel Gauchet : Je ne connais pas de réponse à cette question, mais il est important de la poser. Il faut la remettre au centre de la réflexion. Elle est disqualifiée aujourd'hui à la fois par la tentative communiste de maîtriser l'économie, et par le relatif échec des politiques de régulation d'inspiration sociale-démocrate ou keynésienne. Les difficultés de l'idée de maîtrise de l'économie ont consacré l'idée d'une économie sans maître. J'entends par économie, disons le capitalisme industriel de marché, avec les différents problèmes que son fonctionnement soulève. Nous n'avons pas d'alternative à ce capitalisme, et nous savons que la propriété collective n'est en aucun cas une solution. Est-ce à dire qu'il n'y a qu'à s'incliner et à laisser faire, laisser passer ? Je ne le crois pas. Une fois de plus, ne prenons pas une conjoncture pour la fin de l'histoire.
J'observe d'abord que ce capitalisme est dans un moment singulier. Il est saisi de démesure, comme si plus la richesse collective augmentait, plus le désir de richesse s'accroissait. Mettons-nous en pensée à la place des utopistes du XIXe siècle qui rêvaient d'une époque d'abondance qui mettrait fin à l'exploitation de l'homme par l'homme, le niveau de richesse que nous avons atteint leur paraîtrait à coup sûr suffisant pour qu'il n'y ait pas besoin d'aller plus loin. Or c'est le contraire qu'on observe. La cupidité de l'humanité contemporaine paraîtra un jour bizarre à nos descendants. Ce déchaînement de l'avidité capitaliste au sommet de la richesse ne me semble pas correspondre, contrairement aux assertions des prophètes de l'économie, à un état de nature destiné à se perpétuer toujours, mais à une conjoncture historique singulière. Elle relève d'une fuite en avant comme on en constate d'autres sur d'autres terrains.
Deuxième observation, toujours dans la perspective de faire ressortir les contradictions sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, cette frénésie se paye d'une destruction du capital structurel qui permet au capitalisme de fonctionner. Le capitalisme n'est pas né dans le vide ; il est apparu en fonction d'un acquis historique. Il suppose au moins des populations éduquées et la sécurité sur des territoires très organisés. Or il est actuellement en train de saper les bases qui lui ont permis de se déployer. C'est d'ailleurs un des aspects intéressants du processus de mondialisation. Le capitalisme se déplace pour avoir à ne pas avoir à assumer ses dégâts. Pourquoi former de la main-d'œuvre ? Il n'y a qu'à en importer ou à aller la chercher là où elle existe. Les Asiatiques sont parfaits ; ils sont polis, disciplinés, travailleurs, tout ce que ne sont plus les rejetons de nos contrées. Il est embarqué dans une sorte de fuite en avant permanente par rapport à ses propres conditions d'existence. Nous n'allons pas tarder à en sentir les effets. La question de la capacité de reproduire les gens capables eux-mêmes de faire fonctionner l'économie capitaliste est d'ores et déjà posée à nos sociétés.
Une critique rationnelle du capitalisme est une des tâches les plus importantes d'aujourd'hui. Je ne peux pas croire, pour l'honneur de l'humanité, que le fait que des techniques de régulation un peu rustiques, naïves, primitives, aient échoué, après avoir produit tout de même d'énormes effets bénéfiques, signifie que le problème est sans solution. Que font nos prétendues « élites » ? Non pas que je sois d'un optimisme à tout crin qui me ferait croire que tous les problèmes sont solubles, mais ceux-là me paraissent appartenir à l'ordre du relativement soluble.
Alain Finkielkraut : Il y a une autre question à laquelle je suis sensible : le maintien de la diversité des métiers. C'est une exigence qui doit pouvoir se formuler à l'égard des politiques. Cette idée m'est venue après le grand déferlement du textile chinois au printemps 2005. J'ai entendu Pascal Lamy dire qu'il ne fallait pas trop se faire de souci parce qu'en France, pays de haute technologie, ce n'était pas si grave. Il vaut mieux être capable de fabriquer des Airbus que des tee-shirts. J'ai trouvé cette phrase blessante pour ceux qui travaillent dans le textile et très inquiétante car on ne va pas se laisser subjuguer par la théorie des avantages comparatifs. C'est là que le « nous » doit pouvoir revenir. Dans quel pays voulons-nous vivre ? De qui voulons-nous être les concitoyens ? Est-ce que, attirés par la Toile, nous allons tous devenir des hommes numériques ? Il y avait le manuel et l'intellectuel. Cette distinction s'estompe: l'homme numérique va régner sur toutes choses. Est-ce vraiment cela que nous voulons ? J'ai ressenti la même angoisse lorsqu'à Roanne les usines de chaussures Charles Jourdan et Stéphane Kélian ont annoncé leur fermeture. Je me suis dit ce n'était pas possible : des ouvriers savent fabriquer des chaussures, ce sont des compétences extraordinaires, on ne doit pas pouvoir les abandonner. Ce qui revient à la politique quand elle prend en charge l'économie, c'est aussi de raisonner en termes qualitatifs et de reposer ces questions en apparence naïves. De quel héritage sommes-nous comptables ? Nous avons une dette, nous ne pouvons pas tout dilapider. L'une des menaces que fait peser sur nous l'économisme, c'est un raisonnement purement quantitatif. Bien sûr, il faut résoudre la question du chômage, mais il importe aussi que le souci de la variété soit toujours présent.
Le Banquet : La difficulté à faire revenir la politique dans la débat provient de la difficulté à trouver des langages ou des leviers qui soient eux-mêmes politiques. On navigue entre plusieurs écueils : si l'on n'arrive pas à réinstaurer le politique, on n'est pas à l'abri d'un politique hypertrophié, comme on en a déjà eu l'expérience au XXe siècle avec les totalitarismes, et sinon de la disparition de cette dimension politique. Une seconde interrogation serait de revenir sur une éventuelle divergence entre vous au sujet de l'État-nation dans lequel Marcel Gauchet voit un possible levier de réactualisation du politique, ce qui n'est pas le cas d'Alain Finkielkraut. Un troisième niveau de réflexion nous amènerait à nous interroger sur ce qui peut se passer au niveau européen. Peut-on y voir, comme le dit Nicolas Tenzer, un moyen de répondre à la disparition du politique, de suppléer aux déficiences que l'on a ici ou, au contraire, l'Europe participe-t-elle d'une illusion, notamment au niveau économique ?
Nicolas Tenzer : Sur la dimension de la politique, on peut revenir sur quelque chose de relativement simple. Le problème qui se poserait à l'homme politique qui entreprendrait d'agir pour le bien commun, serait de se demander : qu'est-ce qui correspond à ce que les Américains appellent l'intérêt national ? Quel est aujourd'hui notre intérêt national ? Chacun peut en avoir une conception différente, mais c'est là-dessus que doit se focaliser le débat politique. Par rapport aux remarques que vous avez émises l'un et l'autre, notamment sur la question de l'école ou le maintien d'un minimum de diversité de notre tissu productif, sujets auxquels on pourrait ajouter l'état de nos universités et de notre recherche, le risque d'une mise à l'écart d'une série croissante de nos populations, la question de l'exclusion, pas uniquement de l'économie mais de tout ce qui est savoir, compréhension du réel, capacité d'intellection, faculté de participer à la vie civique, cette question-là est majeure. La tâche du politique n'est-elle pas un problème pragmatique qui consiste à identifier tous ces points, qui n'ont rien à voir avec les droits à la non-exclusion, à l'environnement sain ou à l'école, ou toute autre fadaise que nous connaissons ? Après, parce que nous ne pouvons pas faire tout tout seuls pour gérer sur le plan stratégique ces éléments, nous pouvons envisager la question des alliances et des coopérations, notamment en Europe.
Marcel Gauchet : Ce sont des questions très difficiles. Il est possible, en attendant mieux, d'esquisser des réponses de principe. Je commencerai par l'Europe. Nous ne savons pas dire ce qu'est l'Europe dans l'état actuel des choses. Qu'est-ce que la construction européenne comme processus politique ? La première leçon du référendum a été cette extraordinaire incertitude qui faisait qu'on avait l'impression que personne ne savait très bien de quoi il parlait. Nous n'en sommes plus au stade où l'Europe apparaissait comme une ressource claire. S'il a été vrai que l'Europe a été un instrument de déblocage, ce n'est plus vrai. À maints égards, j'ai même l'impression que la situation s'est renversée. Il y a une sclérose européenne qui donne le sentiment d'une démarche politique encore plus aveugle, encore plus indifférente à l'évaluation de ses effets que celle de l'État français, dont le procès sur ce chapitre n'est pourtant plus à faire. Dans son état présent, la construction européenne est source d'une immense confusion qui devient facteur de blocage plus qu'un facteur de déblocage.
Pas de relance possible sans changement de méthode. Le processus anti-politique qui a été celui de l'Europe au départ, c'est-à-dire la méthode Monnet, consistant à avancer à petits pas en se situant sur un plan technique, sans dire ce qu'on fait, ne peut plus fonctionner. Ce qui s'est vérifié dans le référendum du 29 mai. Elle crée désormais l'affolement dans l'esprit des population, parce qu'elle est perçue pour ce qu'elle est. Elle ne trompe plus personne. Une politique européenne ne peut plus se cacher derrière son petit doigt. Elle est condamnée à expliciter publiquement ses buts. Le contournement technocratique ne provoque plus que la peur. Or la politique est là pour rassurer en explicitant le chemin à suivre.
Parallèlement au changement de méthode au niveau européen, il faut réévaluer le principe des nations. Elles ne se confondent pas avec la guerre, contrairement à l'image d'Épinal qui leur reste accrochée. Elles portent aussi la possibilité d'une paix dont aucune forme politique antérieure n'était capable. C'est ce qu'illustre précisément la construction européenne depuis un demi-siècle. Elle a été le fait des nations européennes, que l'on sache. Celles-ci, loin de correspondre à une essence figée, se sont profondément transformées. Elles n'ont plus grand chose à voir avec le schéma traditionnel à base de mythes tribaux et de parentés charnelles. Ce sont des communautés historiques dont l'unité naît d'une histoire suffisamment partagée pour qu'elle soit la base d'un projet commun. Elles font toutes la même chose, de manière parallèle, ce qui les voue plus à l'association qu'à la conflictualité. Différentes, mais convergentes, elles ont vocation à s'assembler. C'est en partant des nations qu'on pourra retrouver le sens de la politique, y compris pour les dépasser. On ne les dépassera pas en les contournant et malgré les gens qui les habitent, mais en associant les peuples à ce projet de dépassement.
Alain Finkielkraut : L'Europe a voulu se construire en se quittant et la constitution européenne témoigne de ce paradoxe : défaire l'Europe pour faire l'Europe. Lors de la commémoration du soixantième anniversaire de la libération des camps, tant Robert Badinter que Bronislaw Geremek ont dit : « L'Europe est née à Auschwitz ». Phrase terrible et révélatrice : on appelle « devoir de mémoire » la volonté de se déprendre du passé. Au nom de la mémoire, l'héritage n'est plus assumé, mais répudié puisque tout ce qui se trouvait avant Auschwitz conduisait à Auschwitz. L'Europe choisit de se vider d'elle-même, de s'effacer, de se désontologiser. On évoque les valeurs et les droits de l'homme, non l'histoire et la géographie. Pour n'exclure personne, l'Europe veut n'être personne. Vacuité substantielle, ouverture radicale : telle est, selon le sociologue allemand Ulrich Beck, l'admirable secret de l'Union européenne . On remplace la substance, maléfique, par les procédures. Cette formule magique a détruit l'école. On peut même aller plus loin : quels sont les lieux de la terre qui sont régis par cette alliance ? Les aéroports. Les peuples européens ont montré qu'ils ne voulaient pas d'un tel destin. Ils ont dit « non » à l'Eurodrome. Jusqu'à quand ?
. On remplace la substance, maléfique, par les procédures. Cette formule magique a détruit l'école. On peut même aller plus loin : quels sont les lieux de la terre qui sont régis par cette alliance ? Les aéroports. Les peuples européens ont montré qu'ils ne voulaient pas d'un tel destin. Ils ont dit « non » à l'Eurodrome. Jusqu'à quand ?
Le démon de notre temps est la haine du corps, du corps individuel, corruptible, porteur de mort, et qu'on voudra progressivement remplacer par une machine qui fonctionnera très bien, mais aussi haine du corps politique comme tel. Matérialiste au sens de Tocqueville, c'est-à-dire portée par la passion du bien-être, l'appétit démesuré des jouissances matérielles, notre époque est, en même temps, gnostique. C'est à cela qu'il nous faut essayer de réagir. Voilà pourquoi je reste sensible au thème péguyste des passions charnelles, qui peut aussi donner lieu à une Europe charnelle. La désincorporation, généralisée des valeurs ne me dit rien qui vaille.
Nicolas Tenzer : Sur la question de la constitution européenne et des conséquences de son rejet, on ne peut passer sous silence la question de ceux qui pourraient porter une reconstruction. On pèche là de deux manières, d'abord évidemment parce que le « non » a été aussi incarné par des personnages douteux, mais aussi en raison de l'absence de figuration de l'avenir qui est le leur. Il n'y a pas eu, dans le rejet, un quelconque appel à un projet futur et aucun élément positif à la fois sur notre existence nationale et sur son dépassement. Sur le plan national, la réflexion a été absente sur ce qu'on pourrait éventuellement porter vers l'extérieur, ce qui pose la question essentielle : dans quelles conditions concrètes politiques vivons-nous et celles-ci peuvent-elles permettre la ressaisie d'un projet économique, social, européen ? C'est là où je puis formuler une nuance par rapport à la question européenne telle que vous l'avez formulée. Certes, l'Europe avance de manière peu démocratique, sans projet politique explicite, comme on l'avait déjà vu avec l'Acte unique européen pour lequel peu de dirigeants avaient apprécié à l'avance ses conséquences sur des secteurs majeurs de notre économie. Mais en même temps, quand cette dynamique s'arrête, c'est une partie de l'espoir mis en l'Europe, aussi abstraite et peu incarnée soit-elle, et qu'elle apportait à l'extérieur comme aux jeunes nations démocratiques européennes – je pense certes à l'élargissement – qui s'effondre. Tel est le paradoxe de cette non-politique européenne, constat sur lequel nous pouvons nous accorder, c'est qu'elle représentait malgré tout l'incarnation insatisfaisante de quelque chose qui manque aujourd'hui tant en Europe que dans les nations qui la composent. Le désespoir envers la politique européenne, faute de capacité de rebond, et envers la politique tout court risque d'être encore plus grand.
Le Banquet : Où pourrait alors s'opérer concrètement la ressaisie de la politique ? Faute de réponse possible, devons-nous conclure que le pessimisme est devenu notre réalisme ?
Alain Finkielkraut : Je me suis engagé sur la question de l'école pendant des années et je suis maintenant tenté de lâcher prise. Je n'y crois plus. Un ressaisissement est-il encore possible ? On ne facilite pas la tâche des hommes politiques. On peut estimer qu'ils n'ont pas d'idées et qu'ils sont devenus interchangeables. En même temps, ils sont sous la surveillance des médias totalement idéologisés qui, dès qu'ils vont dans la bonne direction, les torpillent avec une violence inouïe. Cela a été le cas de François Fillon quand il a voulu réintroduire la dictée à l'école. Il n'y a pour moi de politique possible qu'émancipée du politiquement correct. Or, les choses sont arrivées à un tel point que ce n'est pas tant le courage qui manque que l'idée même de penser autrement. Sur la question de l'école, c'est saisissant : les automatismes verbaux règnent désormais sans partage. Il faut lutter contre l'échec scolaire. Mais qu'est-ce que l'échec scolaire ? C'est, dit-on, l'échec de l'école et non celui de l'élève. Imputer à celui-ci la responsabilité au moins partielle de son parcours, cela apparaît comme une humiliation et même une violence quasi-raciste commise à son endroit. L'élève est donc un produit, mais en même temps un client qui se fâche quand le produit livré n'est pas bon ! C'est dès lors le fonctionnement même de la transmission qui est remis en cause. Celle-ci suppose la coopération des uns et des autres, c'est un drame qui se joue à plusieurs à chaque fois, mais on ne peut plus parler en ces termes. Une folie compassionnelle s'est emparée de tous et on aligne la réalité scolaire sur le cas de l'élève en grande difficulté. Or, en face de cette grande sollicitude humanitaire, l'humanisme est sans voix.
Propos recueillis par Perrine Simon-Nahum


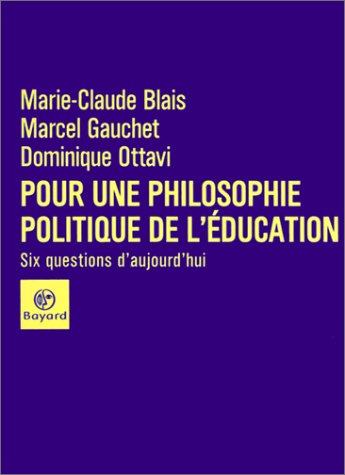


.jpg)














